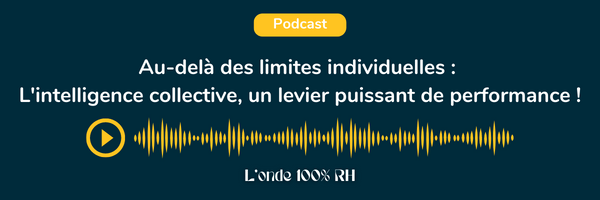Les entreprises évoluent dans un monde de plus en plus complexe, mouvant, interconnecté.
Les solutions toutes faites, les décisions descendantes et les expertises en silos ne suffisent plus. Face à des problématiques multidimensionnelles telles que le climat social, la transformation, l’innovation, le désengagement… Un besoin émerge alors : réfléchir autrement et surtout ensemble.
C’est dans ce contexte que la notion d’intelligence collective en entreprise s’impose peu à peu comme une promesse. Celle d’un collectif capable de produire des réponses plus pertinentes, plus adaptées, plus agiles que l’intelligence individuelle, si brillante soit-elle.
Mais cette promesse est-elle tenue ?
Pas toujours. Parce qu’entre l’envie sincère de “faire ensemble” et la mise en œuvre d’une vraie dynamique de pensée collective, il y a un monde.
Collaboratif, participatif, intelligence collective : une confusion courante
Collaboratif, participatif, co-construit, transversal… Ces termes se sont imposés dans le vocabulaire managérial des dernières années. Ils traduisent un besoin réel : impliquer les collaborateurs, décloisonner les silos, ouvrir la prise de décision.
Pourtant, à force d’être utilisés de manière interchangeable, ces concepts finissent par se confondre.
Or, ils ne recouvrent pas les mêmes réalités :
- Le collaboratif, c’est faire ensemble, sur un projet ou une mission partagée.
- Le participatif, c’est inviter les collaborateurs à donner leur avis, à s’exprimer, à contribuer.
- L’intelligence collective, elle, vise à faire émerger une pensée partagée, qui dépasse la somme des individus, en croisant les points de vue pour répondre à des enjeux complexes.
Ces approches ont chacune leur valeur. Mais elles ne produisent pas les mêmes effets. Or, dans beaucoup d’organisations, on appelle intelligence collective ce qui relève simplement de la réunion participative ou du projet collaboratif bien mené. Ce glissement sémantique entretient une confusion qui nuit à l’efficacité des démarches.
Définir l’intelligence collective, ce n’est pas juste “travailler à plusieurs”
Ce malentendu crée de fausses attentes. On pense “faire de l’intelligence collective” en réunissant une équipe pour un brainstorming ou une réunion d’équipe bien animée. Mais ce n’est pas parce qu’on a coché la case “ordre du jour partagé” et qu’on a utilisé quelques post-its que l’on entre dans une véritable dynamique de pensée collective.
De nombreuses études illustrent l’impact positif du travail collaboratif sur la performance. Mais mal maitrisé, cela peut avoir de réelles répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise.
Selon une étude Figma x OpinionWay (nov. 2024), salariés et managers perdent en moyenne 6 heures par semaine à cause de difficultés de collaboration. Pourtant, 87 % des salariés et 90 % des managers affirment que la collaboration est essentielle à la réussite collective. Mais seulement 56 % d’entre eux estiment que leur entreprise leur donne les moyens de collaborer efficacement.
L’intelligence collective repose sur des conditions précises :
- un cadre sécurisant pour favoriser l’expression libre ;
- une diversité assumée des points de vue, des expertises, des statuts ;
- une méthodologie d’animation rigoureuse, qui structure les temps de divergence, de convergence, de décision.
Sans cela, on obtient au mieux un moment d’échange agréable, au pire une illusion d’implication qui génère frustration ou désengagement. Car ce qui distingue vraiment l’intelligence collective, c’est sa capacité à produire une réponse inédite à une problématique complexe, en s’appuyant sur l’intelligence du groupe, pas uniquement sur la somme des idées individuelles.
Pourquoi l’intelligence collective est sous-exploitée dans les entreprises ?
Ce n’est pas par mauvaise volonté. Bien souvent, c’est une question de représentation. L’intelligence collective est perçue comme quelque chose de naturel : il suffirait de “réunir les bonnes personnes autour de la table” pour que la magie opère. Or, ce n’est ni inné, ni automatique, ni toujours spontané.
D’autres freins expliquent cette sous-exploitation :
- Le temps que cela demande (ou que l’on croit que cela demande).
- Le manque de compétence en facilitation, en animation de processus collaboratifs.
- La peur de perdre le contrôle, notamment pour les managers ou les dirigeants, dans un contexte où l’autorité reste un référentiel fort.
- Le désenchantement, aussi : certaines expériences mal menées ont laissé un goût amer aux équipes (“on nous a demandé notre avis, mais rien n’a changé”).

En somme, l’intelligence collective est un levier mal activé, car mal compris. On lui attribue des promesses qu’elle ne peut tenir seule, ou on la mobilise sans les conditions pour qu’elle soit vraiment productive.
Les bénéfices d’une intelligence collective bien accompagnée pour l'entreprise
1. Une meilleure capacité à résoudre les problèmes complexes
L’intelligence collective n’est pas utile pour tout. Mais sur les sujets qui demandent une vision systémique, une pluralité d’approches, une capacité à faire avec l’incertitude, elle fait la différence.
Plutôt que de s’en remettre à quelques “experts” ou à une vision hiérarchique, elle mobilise la richesse du terrain, la diversité des points de vue, l’intelligence contextuelle de ceux qui vivent les enjeux au quotidien.
Résultat : des solutions plus robustes, plus adaptées, plus partagées.
2. Un engagement plus profond des collaborateurs
Quand on demande leur avis aux collaborateurs sans que cela change quoi que ce soit, on crée de la frustration.
Lorsqu’ils sont impliqués dans une démarche structurée qui produit des décisions concrètes, on renforce leur engagement. C’est toute la différence entre le participatif symbolique et l’intelligence collective réelle.
L’effet n’est pas que psychologique : en se sentant partie prenante, chacun s’approprie davantage les décisions, et s’engage dans leur mise en œuvre.
3. Une culture d’apprentissage et de coopération renforcée
L’intelligence collective installe une nouvelle façon de travailler ensemble : plus horizontale, plus ouverte, plus itérative. Elle apprend à écouter, à confronter sans écraser, à chercher le “en même temps” plutôt que le “ou bien”.
Elle donne aussi une place centrale à l’apprentissage continu : sur les méthodes, sur les relations, sur soi-même. Et ça, aucune formation en ligne ne peut le remplacer.
Les conditions pour la muscler (et ne pas la réduire à un effet de mode)
1. Identifier les bons sujets à traiter collectivement
Tout ne se prête pas à une démarche d’intelligence collective.
Vouloir mobiliser un collectif sur des décisions déjà prises, ou sur des sujets purement opérationnels, est contre-productif.
Il faut choisir les bons terrains : des enjeux complexes, transversaux, qui demandent d’associer plusieurs regards. Et surtout, être clair sur ce qui est ouvert… et ce qui ne l’est pas.
2. Créer un cadre clair et sécurisé
La confiance est un prérequis. Sans elle, pas de parole authentique, pas de vraie divergence, pas d’intelligence collective.
Créer ce cadre suppose de :
- poser des règles du jeu claires,
- expliciter les rôles de chacun (participants, animateurs, décideurs),
- garantir un espace de parole où chacun peut s’exprimer sans crainte.
Ce n’est pas une affaire de “bonne ambiance”, mais de structure.
3. Accompagner les managers dans leur rôle de facilitateur
Un manager n’est pas spontanément un facilitateur.
Et pourtant, on leur demande de plus en plus souvent d’animer des temps collectifs, de faire émerger des idées, de réguler les tensions.
Cela nécessite une posture spécifique. Car ils doivent savoir contenir sans diriger, faire converger sans imposer, écouter sans fuir… Et cela change en profondeur la manière d’incarner le rôle de manager.
4. Suivre, ajuster, et ancrer dans la durée
Le risque avec l’intelligence collective, c’est l’effet “one-shot”. On anime un grand atelier, on produit plein d’idées, puis… plus rien. Pas de suite, pas de retour, pas de continuité.
Or, une dynamique collective ne peut produire des effets durables que si elle s’inscrit dans le temps. Cela suppose de faire des bilans réguliers, de partager les avancées, d’ajuster les formats. En résumé, de faire vivre la démarche et pas uniquement de la considérer comme une animation RH.
Faire de l’intelligence collective un levier stratégique
L’intelligence collective ne remplace pas la stratégie. Elle ne remplace pas non plus la décision.
Néanmois, elle change radicalement la manière de construire, d’impliquer, de résoudre et même d’innover.
D’autant plus si elle est cadrée, structurée et pleinement intégrée dans les processus de l’entreprise.
Chez Jalan, nous croyons qu’elle est un levier de performance autant que de transformation. Mais à condition qu’on cesse de la confondre avec un moment sympa en post-it.
Il est essentiel qu’elle soit pleinement considérée comme une compétence collective à cultiver, à structurer, à muscler.

Avec un parcours tourné vers l’humain, de manager à cheffe d’entreprise, Céline rejoint Jalan en 2023 pour accompagner les collaborateurs à devenir acteurs des transformations de leur organisation. Son moteur : développer les compétences et les dynamiques collectives au service d’une performance durable.
Souhaitez-vous une version plus institutionnelle, plus personnelle, ou un brin plus poétique ?