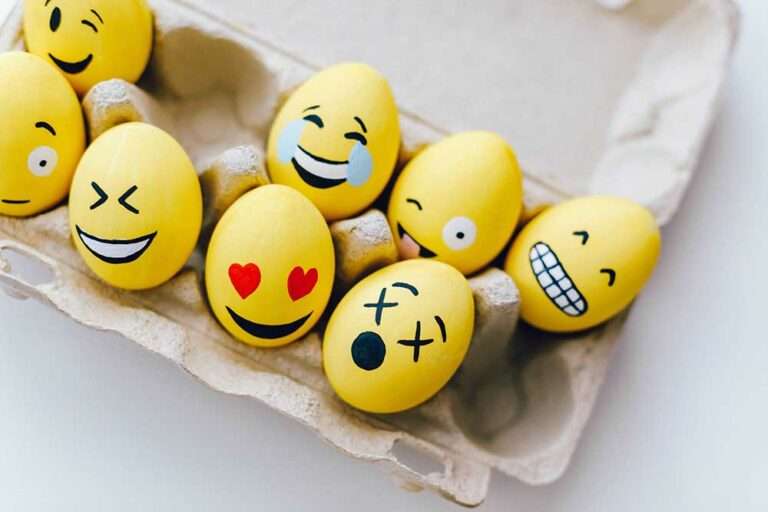En 2025, selon le Baromètre sur l’absentéisme de Malakoff Humanis, 54 % des salariés déclarent subir du stress au travail. Et ce chiffre grimpe jusqu’à 66 % chez les moins de 30 ans.
Depuis 2020, le sentiment d’épuisement professionnel ne cesse d’augmenter, malgré les efforts des entreprises pour prévenir les risques psychosociaux.
Formations, programmes de QVCT, séminaires… les initiatives se multiplient, mais les indicateurs RH (absentéisme, turnover, tensions internes) n’évoluent pas toujours comme prévu.
Pourquoi ? Parce que le stress est avant tout personnel.
Deux collaborateurs peuvent vivre la même situation professionnelle et réagir de manière totalement différente.
Alors plutôt que de chercher à “supprimer” le stress, pourquoi ne pas apprendre à le comprendre, à le décoder et à le transformer ?
Dans cet article, nous vous proposons 4 clés pour faire du stress un véritable levier d’apprentissage, au niveau de chaque partie prenante de l’entreprise.
4 clés pour transformer le stress en levier d’apprentissage
1. Identifier ses propres déclencheurs (et arrêter de croire qu’ils sont les mêmes pour tout le monde)
Le stress n’est pas une donnée collective uniforme ; il est profondément personnel.
Un même projet peut être vécu comme un défi motivant pour un collaborateur et comme une source d’angoisse pour un autre. Ces réactions dépendent de croyances, de drivers internes (“sois parfait”, “fais plaisir”), de seuils physiologiques différents, d’un vécu passé.
C’est pourquoi la première étape consiste à amener chaque collaborateur à comprendre ses propres sources de stress :
- Quels sont mes déclencheurs typiques ? (charge mentale, charge de travail, relations, manque de reconnaissance, imprévu ?)
- Quels signaux physiques ou émotionnels indiquent que la pression monte ?
- Quelles ressources personnelles ou contextuelles permettent de réguler cette tension ?
Cette prise de conscience individuelle change tout : le collaborateur peut anticiper, mobiliser ses ressources et ajuster ses comportements avant d’atteindre le point de rupture.
2. Aider les managers à décoder les réactions de leur équipe
Le rôle du manager n’est pas de “réparer” le stress de ses collaborateurs, mais de comprendre que chacun le vit différemment.
Certains réagissent au changement par l’enthousiasme, d’autres par la résistance. Certains se stimulent sous pression, d’autres se bloquent. Sans cette grille de lecture, le risque est de traiter tout le monde de la même manière : mêmes injonctions, mêmes deadlines, mêmes attentes… avec des effets très inégaux.
Former les managers à détecter les signaux de stress (tensions, retrait, irritabilité, baisse d’initiative) et à poser des questions ouvertes (“Qu’est-ce qui te met en tension ?”, “De quoi as-tu besoin ?”) crée un environnement où la parole est légitime.
Cela ne règle pas tout, mais cela ouvre la voie à une régulation collective beaucoup plus efficace.
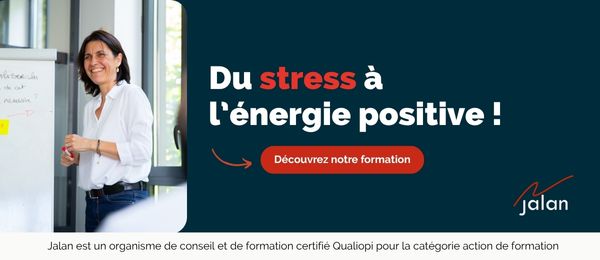
3. Développer des compétences de régulation personnelles et collectives
Une fois la prise de conscience faite, il s’agit de donner des leviers concrets :
- Côté collaborateur : apprendre des techniques de respiration, trouver du temps pour le sport, clarifier ses priorités, poser des limites, s’autoriser à demander de l’aide… Il est essentiel de trouver le format qui correspond à chacun.
- Côté manager : créer des moments réguliers de régulation des tensions, clarifier les priorités, donner des marges de manœuvre, reconnaître les efforts. Pour pouvoir accompagner et épauler ses équipes, il est d’abord primordial de les connaitre.
C’est cette combinaison qui transforme la gestion du stress en un système vivant et autonome : chacun prend sa part (maîtriser son propre stress), et le management crée les conditions pour que l’équipe fonctionne en énergie positive, même sous pression.
4. Installer une culture où parler du stress n’est pas un tabou
Le stress est souvent perçu comme un aveu de faiblesse : “Si j’en parle, c’est que je ne tiens pas la route.” De ce fait, beaucoup se taisent… parfois jusqu’à l’épuisement.
Inscrire la gestion du stress dans la culture d’entreprise, c’est normaliser la discussion, valoriser l’adaptabilité et reconnaître que la capacité à réguler son stress est une compétence professionnelle au même titre que la communication ou la gestion du temps.
Les bénéfices d’une approche stratégique de la gestion du stress
4. Installer une culture où parler du stress n’est pas un tabou
Le stress est souvent perçu comme un aveu de faiblesse : “Si j’en parle, c’est que je ne tiens pas la route.” De ce fait, beaucoup se taisent… parfois jusqu’à l’épuisement.
Inscrire la gestion du stress dans la culture d’entreprise, c’est normaliser la discussion, valoriser l’adaptabilité et reconnaître que la capacité à réguler son stress est une compétence professionnelle au même titre que la communication ou la gestion du temps.
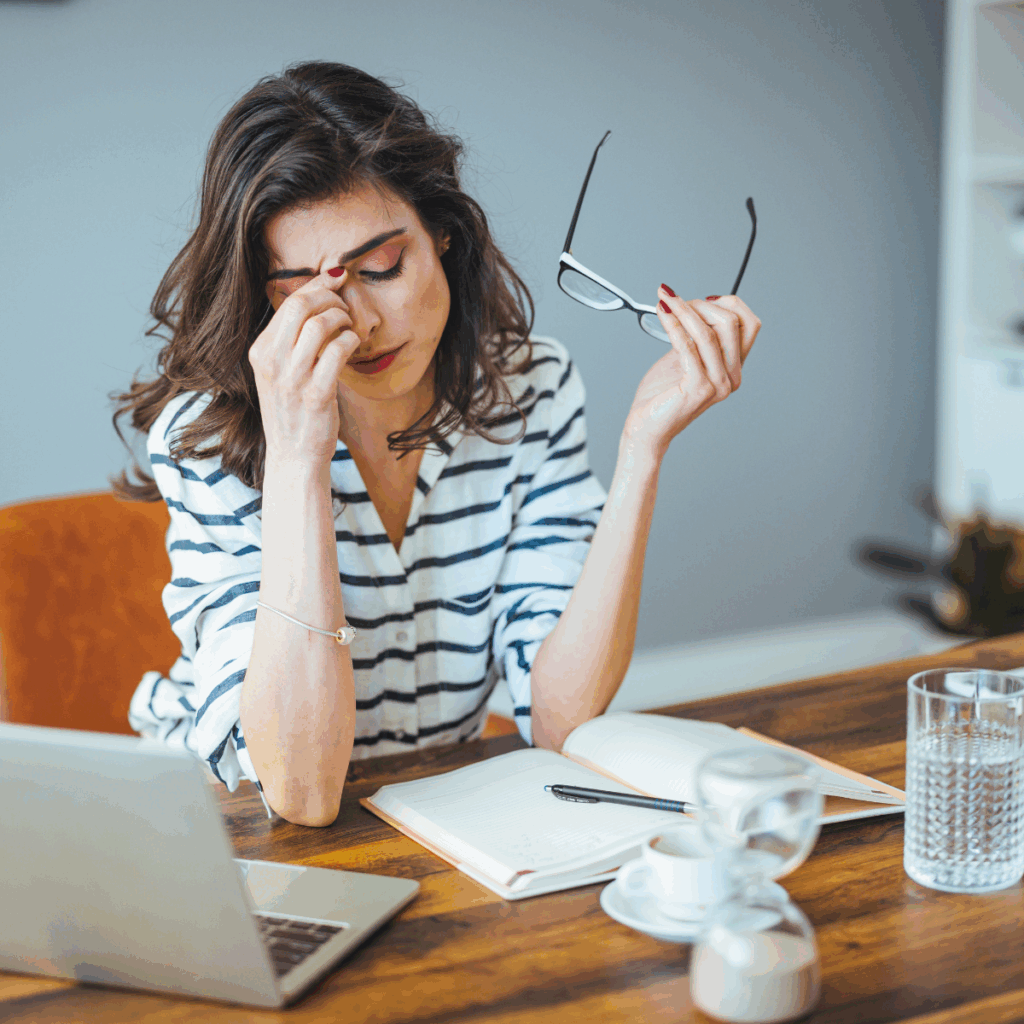
Un climat social apaisé
Les tensions sont régulées et le climat social est alors plus apaisé. La confiance s’installe, les relations se fluidifient, l’information circule mieux. Globalement, l’entreprise gagne en sérénité et en capacité d’adaptation.
Une performance durable
Moins de stress subi signifie moins d’absentéisme, moins de turnover et plus de disponibilité cognitive pour les sujets de fond. Les collaborateurs peuvent se concentrer sur la création de valeur plutôt que sur la gestion de leurs propres blocages internes.
Une attractivité renforcée
Dans un marché du travail tendu, l’image que reflète l’entreprise est un levier d’attractivité des candidats. Encourager un environnement de travail plus apaisé se reflète sur votre marque employeur car vos collaborateurs sont vos premiers ambassadeurs. De plus, c’est un facteur indéniable de fidélisation.
Et si le stress n’était plus subi mais devenait un véritable allié pour vos équipes ?

Le stress n’est pas un ennemi à combattre, mais un signal à écouter et à transformer. Reconnaître sa dimension personnelle et développer des ressources adaptées permet de passer d’une logique de réaction à une logique de prévention et de performance durable.
Chez Jalan, cette conviction guide l’accompagnement des RH, des managers et des collaborateurs : identifier les déclencheurs, développer la régulation individuelle et collective, créer une culture de résilience.
Et si la prochaine étape pour votre organisation consistait à faire du stress un levier de collaboration et de performance ?